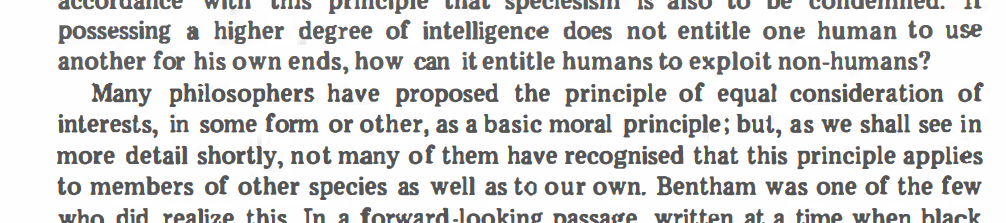J’ai dit récemment sur Twitter que ce mois de janvier serait une bonne occasion d’expliquer pourquoi je ne suis pas sûr que les démarches véganes et abolitionnistes soient les meilleures démarches pour réduire la souffrance des animaux. Voici donc un premier article en guise d’introduction sommaire sur la question.
La consommation des animaux, une question morale de taille
Je pars du principe que la consommation d’animaux est bien une question morale fondamentale : l’humanité tue pour sa consommation probablement de l’ordre de 1000 milliards d’animaux chaque année (en comptant les animaux marins). Je considère aussi que la sentience des animaux est digne de considération, et qu’ils ont pour la plupart de ceux que nous consommons la capacité de ressentir douleur et émotions. Et que ce n’est pas le cas des végétaux, champignons ou micro-organismes. Je pars donc du postulat que notre consommation d’animaux, telle qu’elle se pratique actuellement, cause une quantité considérable de souffrances, et que réduire autant que nous le pouvons cette souffrance devrait faire partie de nos préoccupations majeures.
Pour y réfléchir, je vais partir d’un argument de type conséquentialiste (utilitariste, précisément), celui de Peter Singer (que vous connaissez sans doute grâce à Monsieur Phi, ou alors vous pouvez faire une recherche rapide, mais ce n’est pas nécessaire je pense pour comprendre la suite de mon article). Il y a d’autres approches, mais celle-ci me semble centrale et est fréquemment utilisée. Je commencerai donc par cet argument.
L’argument moral de Peter Singer
En 1972, Peter Singer, à propos d’une famine au Bengale, outré du peu de réactions des riches occidentaux, qui en sacrifiant une faible part de leurs revenus ou de leurs économies auraient pu considérablement alléger la souffrance des Bengalis, formulait cette règle morale :
S’il est en notre pouvoir d’éviter que des choses mauvaises arrivent, sans pour cela sacrifier quoi que ce soit d’importance morale comparable, nous devons, moralement, le faire.
[voir sources à la fin de l’article]
Appliqué à la cause animale, cela donne quelque chose comme ça :
- S’il est en notre pouvoir d’éviter l’immense catastrophe morale qu’est la souffrance des animaux…
- Et si l’éviter ne nous impose pas de sacrifier quoi que ce soit d’importance morale comparable…
- Alors, nous avons le devoir moral de tout faire pour y parvenir.
Et je suis d’accord avec ça. J’ajouterai qu’avoir le devoir moral de le faire, ça ne veut pas simplement dire que ce serait bien de faire un petit effort. Ça veut dire qu’on est en droit d’exiger de mettre en œuvre des stratégies dures pour le faire, de demander par exemple que soient instaurées des lois, des sanctions, des taxes, etc.
Notre devoir moral, c’est de défendre la meilleure stratégie possible
J’ajouterai encore un point fondamental : s’il existe plusieurs stratégies permettant de réduire la souffrance des animaux, puisque cette souffrance est une catastrophe morale, nous avons le devoir de plaider pour la stratégie la plus effective.
Évaluer la stratégie la plus effective (c’est-à-dire celle qui a le plus d’effets positifs concrets en valeur absolue) nécessite de prendre en compte au moins trois aspects : l’efficacité théorique de la stratégie ; les risques d’effets indésirables graves ou au moins significatifs qu’elle comporte ; ses chances de réussite. Une stratégie parfaitement efficace théoriquement, mais dont les chances de succès seraient faibles et qui ferait courir des risques importants pourrait alors être moins morale qu’une stratégie un peu moins efficace théoriquement, mais qui aurait de bonnes chances de réussite sans faire courir de risques majeurs.
Abolitionnisme et welfarisme
Dans une optique d’action vis-à-vis de l’élevage (la souffrance qu’il cause aux animaux, mais on pourrait évoquer aussi les problèmes environnementaux), nous avons de nombreuses stratégies possibles. Pour simplifier un peu les choses, et parce que ce sont historiquement deux grands mouvements de l’animalisme, je prendrai l’exemple du welfarisme et de l’abolitionnisme (on pourrait adjoindre utilement le sentientisme, je pense, mais ça ferait beaucoup pour un article d’introduction).
Abolitionnisme
L’abolitionnisme vise une suppression pure et simple de l’élevage de rente (industriel ou pas), et des autres formes d’exploitation des animaux (principalement la pêche, en termes de volume). Éliminer l’exploitation des animaux devrait diminuer considérablement les souffrances causées par les humains par rapport à la situation actuelle, même si l’on prend en compte par exemple les souffrances causées pour la production de cultures végétales (pas la souffrance des plantes, celle des animaux qui sont éliminés volontairement pour protéger les cultures ou les récoltes, ou qui sont tués ou blessés involontairement lors des processus de production, stockage, etc.).
L’abolitionnisme suppose des actions collectives contre l’élevage et la pêche, mais aussi l’adoption d’un mode de vie végan et une alimentation végétalienne ou quasi-végétalienne pour tous (soit préalablement, pour participer à la disparition de l’exploitation des animaux, soit comme conséquence de la disparition de l’exploitation des animaux).
Welfarisme
Le welfarisme propose plutôt que l’on travaille à améliorer les conditions de vie (et de mort) des animaux qui servent à notre économie et à notre alimentation. Cela suppose de supprimer les situations les plus problématiques si elles ne sont pas améliorables, de les améliorer si elles sont améliorables, et de toute façon d’améliorer l’ensemble des systèmes autant que possible, même les meilleurs. Le but n’est pas forcément d’éliminer la souffrance causée par les humains, mais de la minimiser autant qu’il est possible.
Comparer les stratégies
Je vous ai dit que, pour moi, c’est la stratégie la plus effective qui doit être moralement choisie. Et c’est bien entendu ici que les choses se corsent. Parce que l’ensemble des trois points qui me semblent fondamentaux (l’efficacité théorique, les risques encourus et les chances de succès) sont difficiles à évaluer dans tous les cas. Mais ce n’est que par ce travail d’évaluation des conséquences réelles de chaque stratégie que l’on peut déterminer laquelle est la plus effective, et donc la plus morale.
Afin de faire un choix entre ces stratégies, il convient donc d’évaluer le potentiel théorique de réduction de la souffrance de chacune. Ce n’est pas forcément simple. Et il y a tout un corpus de réflexion sur le sujet. La bonne manière de poser la question est selon moi : si on supprime quelque chose, qu’est-ce qui le remplace ? Dans quelle mesure ce qui le remplace cause-t-il plus ou moins de souffrance ? Si l’on modifie quelque chose, dans quelle mesure cela diminue-t-il ou augmente-t-il la souffrance ?
Évaluer les risques encourus est fondamental, dans cette perspective singerienne. Il est impératif de s’assurer que la stratégie que nous voulons mettre en œuvre ne risque pas de causer une catastrophe morale d’ampleur comparable à celle que nous voulons éviter. Dans le cas de l’abolitionnisme, on peut par exemple arguer qu’abolir l’exploitation animale, notamment l’élevage et la pêche, dans de nombreuses régions du monde, porte un risque majeur de déstabilisation des territoires, de la sécurité alimentaire et de malnutrition [voir ici], aux conséquence possiblement catastrophiques, non seulement pour les humains, mais possiblement pour les animaux eux-mêmes. De plus, l’abolition de l’exploitation animale imposerait de fait à tous de devenir végétaliens (ou à presque tous, certaines formes de consommation animale pouvant être considérées comme véganes selon certains critères, mais ne seraient probablement pas accessibles à tous). On peut espérer que nos technologies et nos systèmes de santé nous permettent de devenir végétaliens (par exemple en fournissant gratuitement des compléments alimentaires et un suivi nutritionnel à tous), mais on peut craindre que cela cause malgré tout de vrais problèmes de santé à une fraction non négligeable, voire importante, de la population, d’autant que l’on peut se demander si les études existantes sur la question sont suffisantes et de suffisamment bonne qualité [voir ici].
La question des chances de succès est elle aussi fondamentale. Quelle est la stratégie la plus à même d’emporter l’adhésion du plus grand nombre ? D’être réellement appliquée ? D’être compatible avec ce que sont les humains, les sociétés et leur histoire ? L’impact sur les animaux (et sur l’environnement) dépend bien plus de ce qu’on réussira à faire que de ce qu’on espérera pouvoir faire.
Si l’on est utilitariste, notre devoir moral est de nous intéresser aux effets réels, pas d’espérer des résultats à partir de présupposés théoriques.
Si l’on veut trancher entre welfarisme et abolitionnisme (ou éventuellement proposer toute autre stratégie), c’est l’ensemble de ces aspects qu’il faut discuter. Chacun des points est complexe, et je n’ai pas abordé, loin de là, l’ensemble des questions qu’il faudrait se poser. Ce n’était pas le but de cet article, qui vise seulement à présenter des bases de réflexion. J’essaierai de trouver un peu de temps pour d’autres articles, mais en attendant, vous pouvez visiter le site [ALEPH2020] auquel je participe, et qui rassemble autant que possible les données scientifiques sur ces questions (vous pouvez avoir une traduction presque acceptable en français en choisissant cette langue en bas d’une page).
Note sur quelques autres approches
Comme je l’ai dit en introduction, les arguments conséquentialistes ne sont pas les seuls arguments à évaluer sur la question de la souffrance animale. Les arguments de type déontologique sont aussi intéressants dans ce cadre, et pourront servir de complément à cette première approche. Et bien sûr, welfarisme et abolitionnisme ne sont pas forcément les seules stratégies possibles. Mais ce sera pour une autre fois, peut-être.
Sources
Famine, affluence, and morality [PDF en] [Traduction fr]
Peter Singer
Philosophy & Public Affairs, 1972
All animals are equals [PDF]
Peter Singer
Philosophic exchange, 1974
Page de sources sur la [philosophie de l’animalisme], pas encore bien rangée et largement incomplète, mais néanmoins intéressante.
Peter Singer + probabilités = Michael Huemer, expliqué [ici] par Monsieur Phi.